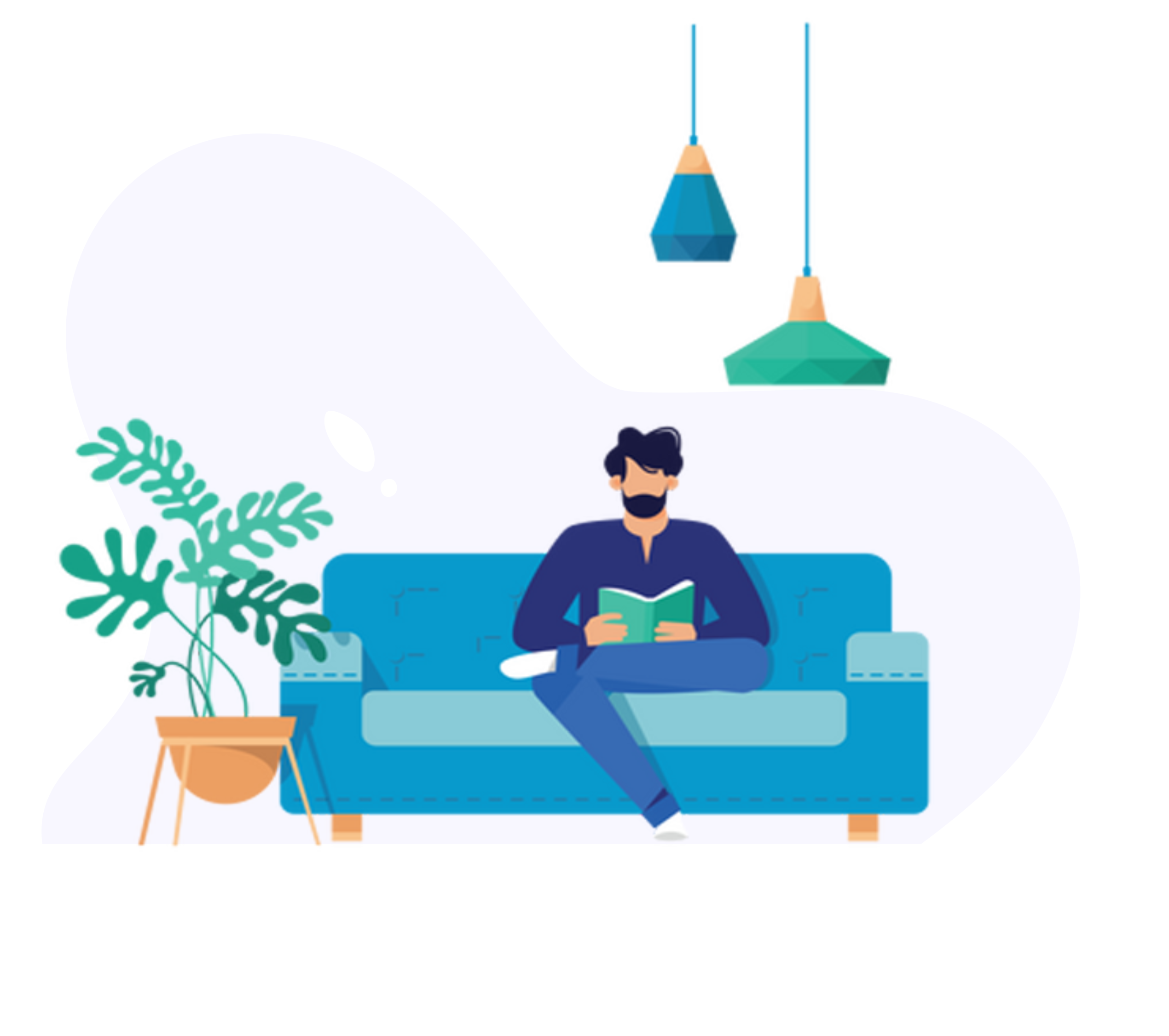- Ces informations tiennent compte des règles en vigueur au 1er septembre 2023.
La FAQ de la retraite
Allianz répond aux questions que vous vous posez sur la préparation de la retraite !
En principe, pour prendre votre retraite à taux plein, c’est-à-dire sans abattement, vous devez avoir validé un nombre de trimestres donné et avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite.
Le nombre de trimestres à valider est fonction de votre année de naissance. Pour toutes les personnes nées en 1965 ou après, vous devrez justifier de 172 trimestres cotisés. Avant cette date , le nombre de trimestres varie entre 167 et 172 en fonction de votre année de naissance.
Notez que votre situation personnelle peut également avoir un impact sur le nombre de trimestres d’assurance requis (carrière longue, pénibilité, maladies, nombre d’enfants…).
Autre option pour bénéficier de la retraite à taux plein : avoir 67 ans. C’est l’âge du « taux plein automatique » (ou âge d’annulation de la décote), à partir duquel la retraite est calculée sans décote quel que soit le nombre de trimestres cotisés.
Vous pouvez faire le point sur votre situation en téléchargeant l’application Mon compte retraite de façon à connaître le nombre de trimestres restants à valider pour obtenir le taux plein.
Légalement, il faut avoir au moins l’âge légal de départ à la retraite (entre 62 ans et 64 ans selon votre année de naissance) pour prendre sa retraite et toucher sa pension. Pour autant, à cet âge-là, il n’est pas garanti que vous ayez suffisamment cotisé pour pouvoir toucher votre pension à taux plein. En effet, selon son année de naissance, il faut avoir validé entre 167 et 172 trimestres pour bénéficier du taux plein.
Sachez que si vous décidez de partir à la retraite avant d’avoir cotisé assez de trimestres, une décote définitive de 1,25 % par trimestre manquant sera appliquée sur votre retraite du régime de base ainsi qu’une décote définitive sur votre retraite complémentaire.
Plusieurs solutions s'offrent à vous :
Dans tous les cas, nos conseillers Allianz peuvent vous accompagner.
Il est possible de partir à la retraite avant d’avoir atteint l’âge légal. Des dispositifs de départs anticipés ont été mis en place et s’adressent, sous conditions :
L’année de vos 55 ans, vous recevez automatiquement une estimation indicative globale (EIG). Il s’agit d’une synthèse des droits que vous avez acquis au cours de votre carrière, auprès des différents régimes de retraite.
Cette synthèse vous présente une estimation du montant de votre retraite avec des simulations en fonction de votre âge de départ. Elle est mise à jour et envoyée tous les 5 ans. Il est important de bien vérifier l’exactitude des informations relatives à votre carrière contenues dans ce document.
Avant vos 55 ans, pour une première estimation, vous pouvez utiliser le simulateur retraite Allianz pour estimer votre pension en fonction de votre âge de départ. Pour les salariés du privé, la simulation permet d’obtenir un montant moyen tenant compte des pensions du régime de base et de la complémentaire AGIRC-ARRCO.
Votre retraite est calculée en prenant en compte le régime de base (selon un système de trimestres) et votre retraite complémentaire (selon un système de points).
Le taux est calculé selon un système de décote et de surcote. Si vous avez validé le nombre de trimestres requis et atteint l’âge légal ou que vous avez 67 ans (âge du taux plein automatique), vous n’aurez ni décote ni surcote. Le taux maximal de 50% s’applique.
En revanche, le montant de votre pension :
Le calcul du montant de votre retraite complémentaire Agirc-Arrco se fait ainsi :
La retraite complémentaire Agirc-Arrco est soumise à un système de bonus / malus*.
Certaines conditions spécifiques s’appliquent, n’hésitez pas à vous renseigner sur votre situation personnelle.
Votre conseiller Allianz est là pour vous aider à faire le point sur votre situation et pour vous éclairer dans vos choix.
* Les organisations gestionnaires de l’Agirc-Arrco ont prévu une négociation en septembre 2023. Cette disposition sera susceptible d’évoluer.
Oui, deux dispositifs le permettent : la retraite progressive et le cumul emploi-retraite.
La retraite progressive est un dispositif d’aménagement de fin de carrière qui s’adresse aux salariés du secteur privé, du public et nouvellement pour les indépendants. Il permet de commencer à toucher une partie de sa pension de retraite tout en continuant à exercer son activité professionnelle à temps partiel. Pour en bénéficier, il faut avoir au moins 60 ans, et la durée du travail à temps partiel ne pourra être inférieure à 40 % de la durée de travail à temps complet pour des salariés du privé et, à 50% pour les fonctionnaires. Pendant toute la période de travail à temps partiel, le bénéficiaire de la retraite progressive continue de cotiser et d'accumuler des points pour sa retraite définitive.
Le dispositif de cumul emploi-retraite permet aux retraités de reprendre une activité professionnelle à temps complet ou partiel et de cumuler les revenus de cette activité professionnelle avec leur pension de retraite. Le cumul emploi-retraite peut être total ou partiel. Pour être éligible à ce dispositif, le bénéficiaire doit avoir demandé préalablement la liquidation de l’ensemble de ses pensions de retraite auprès des régimes de retraite obligatoire. La réforme prévoit que de la même façon que la retraite progressive, les cotisations vieillesse versées dans le cadre de la reprise d'activité permettent de bénéficier de droits supplémentaires à la retraite.
Oui et des conditions spécifiques s’appliquent à chaque régime (de base et complémentaire), en fonction notamment de votre âge, du niveau de vos ressources, ...
Il faut toujours interroger les caisses de retraite en amont sur sa situation. Un dispositif de demande de réversion en ligne a été mis en place depuis 2021 pour certains régimes de retraite de base. Vous pouvez faire votre demande au moyen du formulaire ici.
Deux dispositifs principaux sont à retenir : la majoration de durée d’assurance et la majoration de pension pour enfants.
Le premier donne droit automatiquement à la mère des salariés du secteur privé, à 4 trimestres pour la maternité de chaque enfant. Une majoration de 4 trimestres pour éducation est accordée par enfant. Les parents peuvent choisir, d'un commun accord, soit d’attribuer les 4 trimestres à la mère (aucune démarche à faire), soit de les répartir en attribuant 1 ou 2 trimestres au père. La décision est à faire connaître par formulaire Cerfa n° 51767 dans les 6 mois suivant le 4e anniversaire de la naissance de l'enfant.
Dans la fonction publique : la majoration est de 4 trimestres pour chaque enfant né avant 2004, et de 2 trimestres pour chaque enfant né après 2004.
Le second est un bonus appliqué à la pension du régime de base et du régime complémentaire pour l’éducation des enfants.
Les parents d’au moins 3 enfants bénéficient d’une majoration de pension. Pour les salariés du privé et les professions libérales, elle est de 10 % à partir de 3 enfants. Une majoration peut également être accordée pour les salariés du privé en cas d’enfants à charge au moment du départ à la retraite pour la retraite complémentaire Agirc-Arrco et ce quel que soit le nombre d’enfant.
Dans la fonction publique, une majoration de 10% est prévue pour les 3 premiers enfants, puis 5% par enfant au-delà du 3ème enfant.
Les arrêts maladie et les périodes de chômage indemnisés donnent droit à des trimestres.
Chaque période comportant 50 jours de chômage indemnisé donne droit à 1 trimestre de retraite (4 trimestres par an maximum). Chaque période de 60 jours d’arrêt de travail pour maladie donne droit à 1 trimestre de retraite (4 trimestres par an maximum).
En revanche, ces périodes peuvent avoir un effet sur le montant de votre pension calculée sur les 25 meilleures années pour les salariés du privé.
Chaque période comportant 50 jours de chômage indemnisé donne droit à 1 trimestre de retraite (4 trimestres par an maximum). Chaque période de 60 jours d’arrêt de travail pour maladie donne droit à 1 trimestre de retraite (4 trimestres par an maximum).
En revanche, ces périodes peuvent avoir un effet sur le montant de votre pension calculée sur les 25 meilleures années pour les salariés du privé.
Pour demander votre retraite, il vous suffit d’effectuer votre demande en ligne sur le site www.info-retraite.fr sur son compte retraite avec France Connect.
Cette action permet d’informer les régimes de retraite de base et complémentaire à la fois. Nous vous conseillons de commencer votre démarche 6 mois avant la date de départ souhaitée.
Avant de faire votre demande, vérifiez que toutes vos informations sont exactes, que toutes vos périodes de travail, chômage ou arrêt maladie ont bien été prises en compte. Consultez en détail ces informations sur votre Compte retraite.
Le lexique de la retraite
Allianz vous aide à y voir plus clair avec ce lexique tout simple.
Âge légal
L'âge légal de départ à la retraite est l'âge à partir duquel une personne est en droit de partir à la retraite. On parle également d'âge de départ « au plus tôt ». L’âge légal de départ à la retraite évolue progressivement de 62 ans à 64 ans à horizon 2030, à raison de 3 mois par année de naissance. Pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1968, cet âge est aujourd’hui fixé à 64 ans.
Capitalisation (Système de retraite par)
En complément des dispositifs de retraite par répartition (régime de base et complémentaire), les actifs d’aujourd’hui peuvent épargner pour se constituer un futur complément de revenu. Cette capitalisation peut être effectuée dans un cadre individuel (PER individuel, PERP, Madelin, …) ou collectif (PER d’entreprise (PERO et PERECo), PERCo, Article 83, …).
Cotisation
Montant prélevé sur la rémunération brute pour financer les retraites.
Carrière longue
Dispositif de départ anticipé à la retraite pour les personnes ayant commencé leur activité professionnelle très jeune.
Cumul emploi-retraite
Dispositif permettant au retraité de reprendre une activité professionnelle à temps complet ou partiel tout en percevant sa pension. Selon les cas, ce cumul peut être intégral ou plafonné. La réforme des retraites de 2023 prévoit que les cotisations vieillesse versées dans le cadre de la reprise d'activité permettent de bénéficier de droits supplémentaires à la retraite pour le régime de base.
EIG (Estimation Indicative Globale)
Cette EIG est disponible sur le site info-retraite.fr et permet à l’approche du départ en retraite d’évaluer le montant global de la retraite.
Limite d’âge
Âge auquel un fonctionnaire ou un salarié du privé est mis d’office en retraite.
Liquidation
Vérification de vos droits acquis et calcul du montant de votre retraite, préalable à sa mise en paiement. Sauf cas particulier, la liquidation suppose une demande préalable de votre part.
Plan d’Epargne Retraite (PER)
Créé le 1er octobre 2019, le PER est un produit d’épargne qui permet de se constituer un complément de revenu pour sa retraite. Il peut être souscrit à titre individuel (PER individuel) ou collectif via son entreprise (PER d’Entreprise). Au moment de votre départ en retraite, vous pouvez récupérer votre épargne sous forme de rente, de capital ou d’un mix des deux.
Plafond de la Sécurité sociale (PSS)
Référence utilisée par la Sécurité sociale, et par extension par les autres régimes complémentaires et supplémentaires, pour déterminer la base de calcul des cotisations d’assurance.
Pénibilité
Dispositif de départ anticipé à la retraite au titre de l’exposition à différents facteurs tels que le travail de nuit, dans des températures extrêmes, dans le bruit, etc.
Périodes cotisées/validées
Les périodes cotisées correspondent à des périodes au cours desquelles des cotisations retraite ont été effectivement prélevées sur le revenu et versées aux caisses de retraite.
Périodes non-cotisées ou « assimilées »
Périodes qui correspondent à des trimestres attribués sans contrepartie de cotisations dans certaines circonstances : chômage, maternité/paternité, maladie, service militaire.
Pension
Prestation à vie versée à un retraité au titre de son activité passée.
Retraite progressive
Possibilité, sous certaines conditions, de continuer son activité professionnelle à temps partiel tout en percevant une fraction de ses retraites de base et complémentaire. Pendant toute la période de travail à temps partiel, vous continuez de cotiser et d'accumuler des points pour votre retraite définitive.
Surcote
La surcote est un mécanisme qui permet d'accroître le montant de la retraite de base et partiellement la retraite complémentaire en travaillant plus longtemps.
Salaire annuel moyen (SAM)
Elément central de la formule de calcul de la pension de base. Exprimé en euros bruts, il se calcule sur la base des 25 meilleures années dans la limite du plafond annuel de la Sécurité sociale. Pour un fonctionnaire, la rémunération prise en compte pour le calcul de la pension est le traitement indiciaire brut (hors primes) perçu les six derniers mois d’activité.
Bonus-malus*
Nom du système de minoration / majoration temporaire de la retraite complémentaire mis en place par l’Agirc-Arrco depuis le 1er janvier 2019.
Si une personne demande sa retraite complémentaire à la date à laquelle elle bénéficie du taux plein de la retraite de base, sa retraite complémentaire fera l’objet d’un malus temporaire, à savoir une minoration de 10 % pendant trois ans. Cette minoration cesse en tout état de cause lorsque la personne atteint l’âge de 67 ans.
Si elle demande sa retraite complémentaire un an après la date à laquelle elle bénéficie du taux plein au régime de base, elle percevra la totalité de sa retraite complémentaire.
Enfin, si elle décale son départ de deux, trois ou quatre ans, sa pension bénéficiera d’un bonus également allant de 10 à 30 % pendant une période d’un an.
* Les organisations gestionnaires de l’Agirc-Arrco ont prévu une négociation en septembre 2023. Cette disposition sera susceptible d'évoluer.
Décote
Minoration définitive du montant de la pension de retraite de base lorsqu’au moment de la liquidation le nombre de trimestres ou l’âge de départ ne sont pas suffisants.
Demande de retraite en ligne
Dispositif qui vous permet de demander votre retraite auprès d’un seul organisme, pour l’ensemble des activités que vous avez pu exercer en tant que : salarié (l’Assurance retraite) ; salarié agricole, chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, collaborateur et aide familial (MSA) ; chef d’entreprise, conjoint collaborateur, artisan, commerçant et industriel, etc. (indépendants) ; ministre des cultes ou religieux (Cavimac).
Garantie de versement
Engagement de l’Assurance retraite d’effectuer le premier versement de la pension dans le mois qui suit la date de départ sous réserve d’avoir déposé la demande de retraite au moins 4 mois avant la date de départ.
Régime général
Le régime général est le régime de retraite de base obligatoire des salariés et assimilés. Il est géré par la branche retraite de la Sécurité sociale, plus précisément, la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse) au niveau national et 16 CARSAT (Caisses d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail) au niveau régional.
Régimes spéciaux
Régimes de retraite propres à certaines catégories de personnel du secteur public et parapublic principalement. Par exemple, les régimes des fonctionnaires, des salariés de la RATP, des agents de la SNCF, des personnels des industries électriques et gazières.
Répartition (système de retraite par)
Les cotisations versées par les actifs sont immédiatement utilisées pour payer les pensions des retraités. Ce système repose donc sur une forte solidarité entre générations. Son équilibre financier dépend donc du rapport entre le nombre de cotisants et celui des retraités.
Réversion (pension de)
La pension de réversion correspond à une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré décédé (salarié, indépendant ou fonctionnaire). Elle est versée, si certaines conditions sont remplies, à l'époux (et/ou ex-époux) survivant. Il existe sous condition un dispositif pour les orphelins.
Relevé individuel de situation (RIS)
Le Relevé Individuel de Situation regroupe, sur un même document, l'ensemble des droits acquis dans les différents régimes de retraite. Ces droits retraite sont exprimés sous la forme de trimestres retraite, de salaires et de points retraite.
Trimestre
Unité de compte servant de base au calcul de la pension du régime général de la Sécurité sociale. 0n distingue les trimestres cotisés, c’est-à-dire ceux obtenus au titre de périodes travaillées, des trimestres assimilés qui sont ceux obtenus au titre de périodes non travaillées comme la maternité, le service militaire, l’invalidité… Pour valider un trimestre, depuis 2014, il faut avoir cotisé sur la base d’une rémunération minimale de 150 fois le SMIC horaire.
Taux plein
La retraite à taux plein permet de partir en retraite sans abattement. La retraite à taux plein est accordée à tous les assurés qui comptabilisent le nombre de trimestres retraite requis. Le nombre de trimestres retraite requis dépend de l’année de naissance. La retraite à taux plein est également accordée aux personnes se trouvant dans certaines situations particulières (personnes reconnues inaptes au travail, invalides, titulaires de l’allocation aux adultes handicapés, anciens combattants). Le taux plein est accordé automatiquement aux personnes faisant liquider leur pension à partir de 67 ans.
Taux de liquidation
Pourcentage qui s’applique au salaire ou revenu annuel moyen dans les régimes de base.
Taux de remplacement
Ratio entre le montant de la pension de retraite et le revenu perçu à la fin de la carrière.